Trois femmes nues et cinq bien habillées

La Vie Criminelle d’Archibald De La Cruz de Luis Bunuel
De la fumée. C’est ce qui me revient en premier quand je pense à ce film. Et quel film. Vu la semaine dernière, au saut du lit, je ne sais plus quel jour, tout en priant pour que personne ne vienne me réveiller, pas de réveil, pas d’obligations de travail. Archibald De La Cruz est un homme qui se croit monstre depuis qu’il a retrouvé une boite à musique de son enfance. Voilà le film, voilà la simple phrase qui devrait m’aider à comprendre comment écrire Manuel de Cristallographie tout en m’offrant un modèle totalement inatteignable. Bunuel est un réalisateur à la filmographie qui m’apparaît en dent de scie. Un Chien Andalou est bien, Viridiana est sans intérêt, etc. Mais rien, absolument rien de ce que je connais de lui ne s’approche de la qualité de La Vie Criminelle d’Archibald De La Cruz. Tout y est formidable, fluidité des images, de l’histoire, des idées. Un peu comme un amas de grosses bulles de savon qui fusionnent, se séparent, s’interpénètre de façon très moderne. Au début, le spectateur ne ressent vraiment rien pour Archibald : moustachu, un peu fou, un peu vieillot, dans un lit d’hôpital. Vraiment, rien n’est attirant chez lui, rien intéressant ou nouveau, pour ainsi dire. Et puis, une infirmière meurt et Archibald se confesse. Et là, dès la première image de lui, enfant, tout aussi énervant et éloigné du spectateur, quelque chose filtre, comme le souvenir arrive dans une magie de montage qui m’a paru tout à fait neuve, c’est l’histoire d’Archibald qui commence à nous intéresser, la façon dont il se voit et non pas la façon dont il est. En quelque sorte, pendant l’heure et demi qui arrive, nous ne verrons jamais le vrai Archibald tout au long de ses aventures avec les femmes, souvent plus charmantes les unes que les autres, et quand nous le retrouvons, seul, dans un bois, triste, c’est son moi-imaginaire qui irradie l’image et l’on comprend que plus jamais on ne le verra comme il est réellement, même en regardant plusieurs fois le film. Jamais. Au fond, c’est peut-être ça l’amour qui rend aveugle, c’est voir l’autre d’une façon qui n’est pas la bonne, en l’occurrence de la façon dont il se voit lui, et on s’en fout s’il se hait ou s’il s’aime, l’important, c’est l’image, le spectacle de voir le manège des idées, de l’imagination, s’installer sur la façade de l’homme, bien plus beau que le réel.

Les Fleurs et Les Vagues de Seijun Suzuki

J’ai l’impression que, si je suis Suzuki comme cela, c’est qu’un jour il me servira. Je m’explique : ces films marche à force de rediffusion, à force de passer dans le sang, à force de travailler dans la tête. C’est ça le sens de ces images pop dont il est le maître absolu. En regardant les Fleurs et les Vagues, je ne ressentais pas grand chose pour ces personnages, comme dans tous les films de Suzuki, au fond. Mais, à l’inverse des premières minutes de La Vie Criminelle d’Archibald De La Cruz où cette absence d’empathie est un handicap, ici c’est tout l’inverse. Ce que Seijun Suzuki, c’est un voyage dans le temps, idée pop par excellence. Avec son cinéma, on se retrouve dans le Japon dans années 60 ou du début du siècle, et à aucun moment nous est donné l’occasion de nous identifier à un des personnages. En réalité, on observe, pendant une heure et demi, et après, on croit oublier, alors que le film devient des souvenirs. C’est assez impressionnant. Suzuki est un voyage, ce n’est pas partir au Japon, ce n’est pas se retrouver dans les années 60. C’est avoir conscience de voyager dans le temps et se retrouver, protéger par sa capsule, entre les vies de personnages que l’on observe, scientifiquement ou comme Dieu pourrait le faire, des êtres, des personnages sélectionnés pour les couleurs de leurs vies, pour l’intensité de leurs destins. Voilà pour le côté spectateur au premier degrés. Ensuite, grâce à ses « trucs » de réalisateur, absent dans ce film là en particuliers, on peut simplement se contenter d’admirer son cinéma, la beauté de ses plans, la modernité qu’on lui vole souvent, la force de son talent. C’est intéressant aussi, parce que c’est grand. Ça ne marcherait pas avec un demi-doué, ou avec un bonne élève. Ça marche avec Suzuki, ça pourrait marcher avec le Kubrick de certains films. Malgré tous l’honneur que je lui dois, ça ne marcherait pas avec Lynch par exemple. C’est spécial, au sens d’unique, et c’est ça Suzuki Seijun.
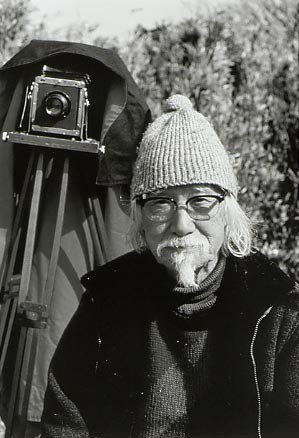
My Summer Of Love de Pawel Pawlikowski
De ce film, on se rappellera surtout la musique, les ambiances. Pas l’histoire, pas les personnages. Tout est invité de toute façon, tout est un mensonge. Non il faut essayer de garder ces petits fragments, comme des vieux rêves, comme des illuminations, des points d’éclairages sur la vie, des instants de noirceur et des douceurs, une heure vingt dans le désordre : Mona et Tamsin sur le court de tennis, Mona s’effondrant sur l’herbe depuis sa mobylette sans moteur, la Ouija Board qui épelle Sadie, Mona étranglant Tamsin dans la rivière, Mona sur la route, ambiance ombragée, Tamsin à la fenêtre, frisson sur la peau, en soutien gorge. Tout ça et d’autres, ce serait déjà bien de ce souvenir rien que de ça. Parce ça revient et ça reviendra. Comme des fantômes qui me hantent. Une mobylette dans un jardin. Ouija Board Ouija Board de Morrissey. La Cascadre de Brisecou (à Rome –quel nom incroyable quand même, pour un endroit qui ressemble étrangement à celui du film). La mobylette rouge de Camille dans Manuel de Cristallographie. Le visage de Tamsin, comme celui des centaines d’autres filles dans les rues en bas de chez moi. Merci. Toutes ces humeurs (In the Mood for love) qui me rappellent tout ce qui me manque depuis 5 mois, les fragments de vie, la musique qui transporte, les bienfaits de l’imagination. My Summer Of Love est sans doute un film de cinéma. C’est-à-dire un film de salle, où l’on peut regarder les autres spectateurs, entendre la musique à plein volume et voir le corps de Tamsin s’étendre sur plus de trois mètres. Il me semble que la seule solution pour le revoir en dvd, c’est de le passer en cut up, en morceaux / fragments semblable au tableau « Cubomanie » de Guerasim Luca, dont l’héroïne ressemble étrangement à la fusion de Mona et Tamsin en cut up. Nouveau CocoRosie, nouveau Devendra Banhart, New Order, j’ai enfin trouvé la bande son qui me manquait, celle qui allait me motiver, celle que je peux écouter en boucle, moi qui l’ai cherché tous l’été, essayant de progresser, d’avancer, de changer, pour finalement me retrouver à écouter les mêmes artistes que ceux qui m’ont bouleversé l’année dernière, mais dans d’autres enregistrements, de la même manière que je n’ai pu commencer de nouveau blog et que je retrouve celui-ci avec une inspiration retrouvée. Je suis le même, depuis toujours. Le même que l’année dernière, et quatre mois de travail n’y ont rien changé. Ce ne sont que de nouveaux souvenirs, de nouvelles histoire, un nouveau roman. Voilà tout. My Summer of Love, c’est moi qui vers 16 ans m’amusait à cut upper deux lettres d’amour que j’avais écrites à deux filles différentes sans jamais leur envoyer.
Days of being Wild de Wong Kar Wai
Préambule : ce film est largement en dessous de In The Mood For Love, 2046, et Chungking Express, bien que ce dernier soit au-dessus d’absolument tout, au même titre que Garden State dont je reparlerai un jour. Days of Being Wild, c’est un peu le brouillon de In the Mood et, surtout, 2046(qui au fond est la fusion de In the Mood et Days of being). Alors c’est moins bien filmé, les chansons sont moins bien passés et se retrouvent souvent sur les BO des deux films suivants. Donc, ils forment une trilogie. In the Mood For Love, c’est le mélo, court, suffisant, classique. 2046, c’est l’œuvre d’un personnage, sa vie, ses pensées, ses secrets bien gardés et ses romans. C’est long, confus, parfaitement filmé, parfaitement mis en place. Days of Being Wild n’apporte rien par rapport à cela. Il représente une version fantasmagorique de Hong Kong (tourné en Argentine), dans laquelle les personnages semblent déplacer comme par la simple magie des chansons qu’ils écoutent. Pluie torrentielle, palmiers, chaleur écrasante dans les immeubles. Le film présente une galerie de personnages plus ou moins intéressantes, avec parmi les meilleurs : Maggie Cheung (mieux que dans In The Mood) et le policier de rue qui préfigure celui de Chungking Express. Par rapport aux autres films de Wong Kar Wai qui m’ont été donné de voir, celui-ci propose une trame originale. Un jeune homme, Yuddi, est partagé entre les femmes qu’il séduit et sa mère adoptive et tyrannique. C’est en quelque sorte, et si ce n’est pas très original, ce qui l’est, c’est la façon dont l’histoire se développe : les personnages se rencontrent, voyagent, se croisent, ils fuient, ils font des erreurs. Par rapport aux autres films de la trilogie, il n’y a pas d’unité de lieu et d’intrigue (In The Mood for love, qui pourrait être du théâtre), ni la prédominance des souvenirs, de leurs agencements, de leur fictionnalisation. Ici l’histoire se déroule sous nos yeux, elles n’est pas contenu par les efforts du cinéaste ou par le montage, et ce n’est qu’à de rares instants de voix off redondants que l’esprit Wong Kar Wai pointe (« Il existe un oiseau sans patte, qui ne fait que voler, et ne pose que quand il meurt »). Alors finalement, qu’en tirer ? Une œuvre de jeunesse qui plaira aux ceux qui n’ont pas vu la trilogie ou qui l’ont vraiment dans la peau. Pour moi, il y a du bon et du mauvais. Les personnages déjà cités sont dans le bon. Dans le mauvais, il y a le personnage de Yuddy et cette confusion, ce manque de clarté qui montre vraiment que ce sont les premiers pas du cinéaste ( me rappelle une projection en plein air de In The Mood, une fille derrière moi : « J’aime bien, mais je comprends pas trop », alors que le film est absolument clair). Malgré tout, en y repensant, certainement en le revoyant, le film reste un bon souvenir, irradier par ses personnages secondaires et par la conscience que l’on acquiert doucement de la nébuleuse Yuddi qui entraîne ses rencontres dans le trou noir qu’il porte au fond de lui.


0 Comments:
Post a Comment
<< Home