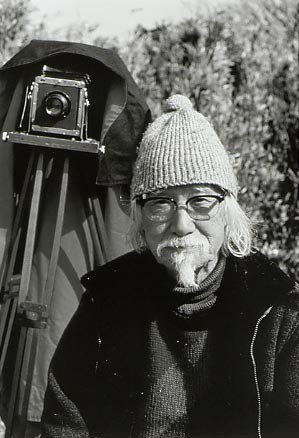Heart Shaped Box

Il y a des jours comme ça, on trouve tout ce qu’on veut à la médiathèque sans avoir à chercher : Kaïro et Mystery Train en dvd, une bio de Woody et un Greil Marcus en bouquins.
Et maintenant j’écoute Show Me Your Tears de Frank Black. Pourquoi ça ? ça fait vraiment longtemps que l’envie ne m’avait même pas traversé l’esprit. Le disque date de Septembre 2003. Sans doute est-ce l’envie d’y retourner. Après je passe à In Utero de Nirvana et ça ne marche absolument pas. Apparemment je n’ai pas envie de redevenir un adolescent, les photos du livret me débectent mais la musique et la production reste géniaux. En Septembre 2003, je n’avais pas encore été touché par Céline, il me restait du temps avant de me mettre à travailler, j’ignorais tout des études que j’allais faire, je croyais qu’il existait des vrais gens. Et puis, je n’avais pas vu les Pixies live. Depuis beaucoup de choses ont changé, j’ai partagé une semaine avec Céline, mon style d’écriture a été bouleversé et a fait un bon énorme d’un seul coup, je lis plus et mieux qu’avant, je vais souvent dans ma salle favorite d’art et d’essai, Peter a signé sa mort en beauté (au Tap’n’Tin, le 8 octobre 2003), j’ai vu Paris, je ne crois plus en personne, spécialement les filles, et puis j’ai vu les Pixies. Si Céline, en me détruisant, m’a immédiatement permis de faire fonctionner mes cellules afin de me reconstruire ( me rendant plus perfectionné et me transformant en ma propre création, les Pixies en me ravissant ( vieux rêve) ont plongé dans le noir cette partie de moi qui les aimaient. Il n’y a pas à dire, le concert était honnête. D’ailleurs il me semble qu’il va même sortir en dvd. Mais c’était l’usine, tout le monde adorait, les chansons s’enchaînait et en fait, c’était exactement comme voir la Star Academy faire une soirée de reprise des Pixies. Un viol de nos secret, doublé de leur appropriation par 20000 personnes. Les Pixies était le secret le moins bien gardé de la scène indie, mais ils étaient le secret de chacun. Là, fini, renversé sur le trottoir, exactement (mais vraiment) comme Pete dans les tabloids, à la télévision, dès qu’il s’agit de rock ou de Kate Moss. Merde, vous avez une boite qui renferme toutes les sessions de Pete et sur laquelle est inscrite « Champs Elysées », vous ? Moi aussi, alors s’il vous plait, n’essayez même pas de parler. Stil, j’écoute Show Me Your Tears et c’est plutôt bien. Même si le gène Pixies est mort et qu’après essai, c’est le seul album de Frank Black qui me fait cet effet là en ce moment.
Dans ma promo, il y a cette fille, plutôt jolie, à laquelle j’ai parlé le premier jour, par accident. Je peux sentir l’attraction, en tout cas de mon côté, alors je la teste. Je me rends compte très vite qu’elle est stupide. Elle est réelle, après tout. Là n’est pas la question, je m’en serai douté, je ne suis même pas déçu. Non, il y a un autre truc. J’ai peur. Elle me plait. Elle me plait comme une femelle plait à un male, c’est primaire, vous avez déjà entendu parlé des glandes sudoripares ? Bref : je n’en ai rien à foutre d’elle, mais il y a quelqu’un en moi pour qui c’est le contraire. Lui je le fais taire depuis longtemps, pourtant comment savoir s’il ne prend pas le contrôle des fois ? Dans ces conditions, je n’ai qu’un seul espoir : que je ne lui plaise pas. Parce que sinon, c’est forcé, nous ne sommes que des humains, je ne résisterai pas, au fond, à l’appel du sexe. Et alors ce sera désillusions sur déceptions.
ET EN MEME TEMPS :
Pourquoi pas ? C’est peut être la solution à mes problèmes. Souffrir. Pour pouvoir à nouveau me reconstruire. Si je suis Moi version 2.quelque chose, est-ce qu’il n’est pas temps de passer en 3.0 ? Il me faudrait à peine une semaine, pleine de peur , de malentendus et d’erreurs. Et hop, je reconstruit à partir des morceaux qui sont par terre. En ce moment, je ne sais même plus quels disques j’aime, quels sont mes réalisateurs favoris, ni comment faire pour écrire de manière originale. C’est un calcul vicieux, non ? C’est ce que mon personnage fait dans « Manuel de Cristallographie » il va se rendre consciemment accro à l’héroïne, il va arnaquer son dealer pour se faire tabasser et puis après, cure de désintox. Apprendre à marcher à nouveau. Marcher mieux. Mieux jouer de la guitare, mieux chanter, mieux parler de tout ce qui vient d’arriver dans ces paroles. C’est exactement ce qu’il me faut. Alors quoi ? Fonce. Il va falloir avaler des couleuvres, être gravement malade pendant une semaine et voir ma réputation totalement détruite à l’université. Tout ça est déjà arrivé. Quelle réputation ? Qui y a-t’il de si bien à l’université pour que je doive y paraître fort ? Franchement.
En plus, quand j’ai vu les Pixies, à cet exact moment, Blandine a disparu. C’est un souvenir très fort que j’ai essayé d’enfuir quelque part en moi et c’est vrai qu’en y repensant maintenant, tout est flou.
Fait : Blandine m’écrit le jour des Eurockéennes. Ce sera son dernier mail (je ne le sais pas en le lisant, elle ne le dit pas). Aux Eurockéennes, je m’amuse, etc, etc. Au concert des Pixies, je pense spécifiquement à elle. Bizarrement, je vois une fille assise avec un mec sur le toit d’un bingalo qui sert de toilettes et je me dit qu’avec ce visage, ces vêtements, ce pourrait être elle, alors je crie son prénom et ma voix est couverte par les amplis des Pixies. Voilà, elle a disparu. Quand je rendre des Eurockéennes, je n’ai pas de nouveaux mails, je n’aurai plus de réponse à aucun de ce que je lui enverrai.
Donc : les Pixies ont fait disparaître Blandine. La nuit qui a suivi ce concert, j’ai dormi dans la tente de mes amis sur le camping des Eurocks. J’ai fait un rêve. Une petite douzaine d’entre nous avait envahi la scène après le concert des Pixies, on courait backstage, dans leur loge, mais je suis un peu à la traine. Le temps que j’arrive, je vois une voiture sortir de la loge, et ils sont tous entassés dedans : les Pixies et les fans qui sont venus avec moi. Ils partent.
Conclusion : déjà pendant le concert des Pixies, je les trouvais moyens. Ils étaient moyens, il n’y a rien à redire là-dessus. En même temps, au même moment, je me rendais compte de la fragilité de ma relation avec Blandine. Depuis, les deux ont fusionnés comme la compil de Peter, Paul and Mary et l’album d’Husker Du dans « Je, la mort et le rock’n’roll ». C’est tout à fait normal, c’est comme ça que fonctionne la mémoire. Ce qui est marrant, c’est que maintenant, les Pixies ne me rendent pas triste. Je les écoute et j’y suis indifférent, c’est pour ça que je ne les aime plus. Parce qu’au fond, ma relation avec Blandine n’a jamais existé. Ce n’était que des mots, sincères mais maladroits (de ma part) et des réponses incroyables, comme si je les faisais moi-même. Voilà tout, ce n’était basé sur rien de normal, rien de vrai. Rien qui compterait aux yeux d’un Juge Officiel des Relations Amoureuses (si ça existait). Alors ce rien s’est mis à pomper l’énergie des Pixies. En 1 heure et demi un samedi soir, les Pixies ont été vampirisé par un de mes souvenirs, afin qu’il puisse être réel. C’est aussi simple que ça. Aujourd’hui, rien n’a changé, Blandine a disparu et je n’ai connu d’elle que ses mots. Mais c’est devenu une réalité, et c’est mon meilleur souvenir amoureux, voire mon meilleur souvenir tout court. Les Pixies eux ne me parlent plus. Leur musique n’évoque plus rien en moi. Au moment où ils sont devenus réels (des disques magnifique d’un groupe splitté il y a dix ans qui, d’un seul coup, en quelques mois, débouchent sur le concert des retrouvailles aux Eurockéenes) ils ont disparus de ma mémoire et ont permis à Blandine de devenir, elle, réelle. Echange standard.
Moralité : quand j’écoute des albums solos de Frank Black, c’est comme si je voyais des souvenirs de Blandine dans lesquels je ne figurai pas encore et dans lesquels je ne figure plus.




.jpg)


.jpg)